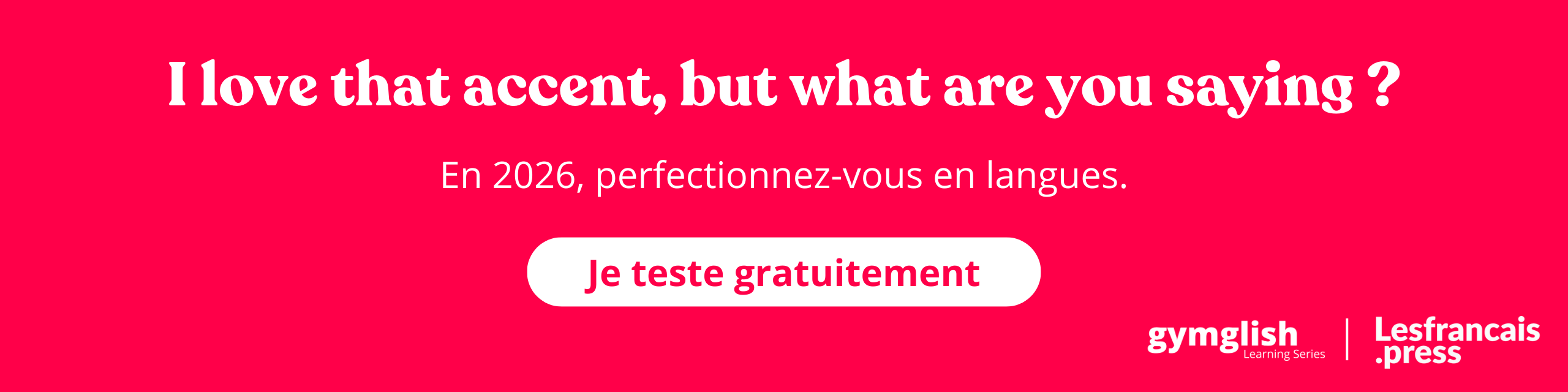La décision de Donald Trump de majorer les droits de douane américains repose sur un pari, celui de la réindustrialisation de son pays, seule à même, à ses yeux, de procurer des salaires décents à sa population. Ce pari passe par la réorientation de la population active vers l’industrie ainsi que par la mobilisation des capitaux en faveur de ce secteur d’activité.
Plusieurs facteurs risquent néanmoins de contrarier le plan du Président américain : le manque d’actifs disponibles, leur faible niveau de compétences, et les coûts élevés de production aggravés par l’inflation.
Une désindustrialisation aux causes multiples
Depuis les années 1990, les États-Unis ont connu une profonde recomposition de leur appareil productif. Le poids de l’industrie manufacturière dans le PIB et l’emploi n’a cessé de diminuer. En 1990, l’industrie représentait encore environ 16 % du PIB et plus de 17 millions d’emplois. En 2025, elle ne pèse plus que 10 à 11 % du PIB et les emplois industriels sont tombés à 12,9 millions, soit à peine 8 % de l’emploi total.
Avec la France et le Royaume-Uni, les États-Unis sont le pays ayant connu le plus fort mouvement de désindustrialisation. Celle-ci doit être néanmoins relativisée. La production industrielle américaine n’a pas baissé en volume. Elle a continué à croître jusqu’à la crise de 2008, puis a stagné. L’économie s’est tertiarisée avec l’essor des services à forte valeur ajoutée en particulier dans le domaine des technologies de l’information et de la communication.
La moindre intensité de main-d’œuvre dans l’industrie s’explique par la progression de la productivité du travail dans l’industrie. Les accords commerciaux, notamment l’ALENA (1994) puis l’adhésion de la Chine à l’OMC (2001), ont accéléré la concurrence mondiale. Les chaînes de valeur mondiales se sont développées, de nombreuses entreprises américaines ont transféré une partie de leur production en Chine, au Mexique ou ailleurs.
La désindustrialisation a touché plus durement certaines régions, notamment le Midwest (ancienne « Rust Belt ») : l’Ohio, la Pennsylvanie, le Michigan, ou encore l’Illinois ont perdu des dizaines de milliers d’emplois industriels. Ce phénomène a accentué les fractures territoriales et économiques.
Le retour en force du protectionnisme
Dès 2017, Donald Trump a engagé une politique commerciale protectionniste avec des tarifs douaniers visant à protéger l’industrie américaine, notamment face à la Chine avec des résultats limités. Joe Biden a mis en œuvre une politique favorisant les investissements sur le territoire américain avec l’adoption notamment de l’Inflation Reduction Act (2022), axée sur la transition énergétique et les subventions à la production domestique, et du CHIPS and Science Act (2022), visant à relancer la production de semi-conducteurs sur le sol américain.

De son côté, l’Infrastructure Investment and Jobs Act (2021) avait comme objectif de renforcer les infrastructures logistiques et énergétiques.
Donald Trump a entamé son deuxième mandat en plaçant l’augmentation des droits de douane au cœur de sa stratégie économique. À la différence des mesures prises lors de son premier mandat, il a décidé de relever tous les tarifs douaniers applicables à tous les pays commerçant avec les États-Unis. Ce choix vise à empêcher des déplacements de production entre les différents pays pour échapper aux droits de douane. Le relèvement des droits vise également à contraindre les partenaires commerciaux à ouvrir plus largement leur marché aux produits américains.
Une politique inflationniste et défavorable à la croissance
La politique américaine est de nature inflationniste. Les droits de douane devraient aboutir à une augmentation des prix des produits importés. Cela aura des effets sur le pouvoir d’achat des ménages et sur les coûts de production. Avec l’éclatement des chaînes de valeur, l’industrie américaine recourt à de nombreux bien intermédiaires importés en provenance en particulier du Canada et du Mexique.
La lutte contre l’immigration illégale devrait également accroître les tensions inflationnistes avec un marché du travail proche du plein-emploi. Une inflation plus importante pénalisera la compétitivité de l’économie américaine et pèsera sur ses exportations.
La politique économique du Président devrait restreindre la consommation, principal moteur de la croissance aux États-Unis. Le moral des Américains est déjà orienté à la baisse, ce qui pourrait induire des changements de comportement dans les prochaines semaines avec une réduction de leurs achats. Aux États-Unis, l’évolution des cours boursiers entraîne des conséquences sur la consommation et l’investissement. En effet, avec la disparition de l’effet richesse que générait la hausse du cours des actions, ces dernières années, les ménages pourraient revoir leur niveau de consommation à la baisse. De leur côté, les entreprises pourraient diminuer leurs investissements, celles-ci se finançant majoritairement via les marchés financiers à la différence de leurs homologues européennes qui privilégient le crédit bancaire.
Une main-d’œuvre insuffisante et mal formée
La réindustrialisation des États-Unis bute sur des problèmes de main-d’œuvre. Le taux de chômage est faible, autour de 4 % de la population active. Certes, le taux d’emploi offre de marges de manœuvre. Il s’élève à 71 % contre 79 % en Allemagne. Néanmoins, la proportion des handicapés (disabled) dans la population est élevée, 11 % des Américains en âge de travailler ont un handicap. Cette forte proportion est imputable en grande partie à la dépendance d’une partie de la population aux opiacées. L’industrie nécessite des salariés bien formés ayant des compétences techniques importantes. Or le niveau des compétences des Américains est bas, comme le souligne l’enquête PIAAC de l’OCDE.
Les coûts de production sont aux États-Unis élevés limitant la réindustrialisation. Celle-ci ne peut passer que par un recours à l’automatisation, ce qui conduira à un faible niveau de création d’emplois.
A terme, la réduction des fonds fédéraux alloués au Center For Disease Control (CDC), à l’Advanced Research Projects Agency – Energy (ARPA-E), l’Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), et à diverses universités (Columbia, John Hopkins) peut entraver la recherche aux États-Unis qui constituait jusqu’à maintenant une de forces du pays. En décidant de suspendre le financement des études sur le changement climatique à l’Environmental Protection Agency (EPA) et en exerçant des pressions sur l’Office of Research Integrity (ORI), le Président américain incite les chercheurs à émigrer.
Aux États-Unis, les droits de douane, les expulsions d’immigrés, la désorganisation des agences fédérales pèsent sur la croissance avec une augmentation de l’inflation à court terme. À moyen ou long terme, une compensation ne peut intervenir qu’à condition de maintenir la compétitivité de l’économie américaine, ce qui suppose une amélioration du niveau de formation des salariés et une augmentation du taux d’emploi. Les mesures prises à l’encontre de la recherche pourraient pénaliser l’attractivité de l’économie américaine sur longue période.
Laisser un commentaire