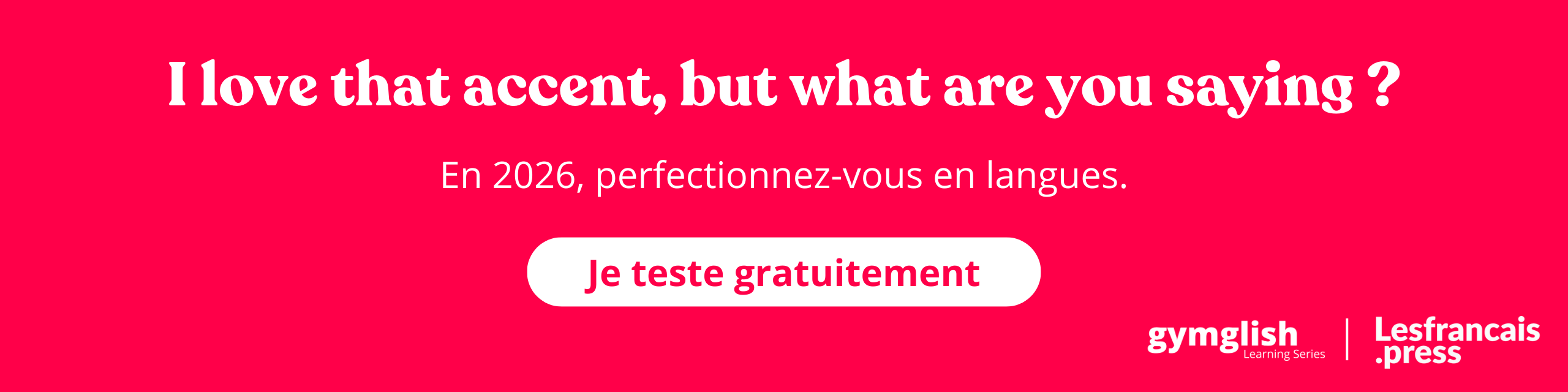Alors que le 21 juillet 2023, la France et l’Allemagne avaient signé un accord bilatéral sur la formation professionnelle, celui-ci devient réel. En effet, le décret portant sur l’application de ce texte vient d’être publié. Et il pourrait même marquer un tournant discret mais décisif dans la manière dont l’Europe aborde ce sujet. C’est en effet un acte important en faveur de l’apprentissage sans frontières, reconnu mutuellement de part et d’autre du Rhin, au service de l’Europe des territoires.
En effet, ce n’est pas une simple déclaration d’intention. Il s’agit d’une avancée concrète, pragmatique, qui répond aux besoins de milliers de jeunes et d’entreprises dans les zones frontalières. Il est aussi le premier résultat tangible de la loi française du 21 février 2022, qui exige des autorités françaises de conclure des accords en matière d’apprentissage avec les États voisins afin de pouvoir proposer un apprentissage transfrontalier ciblé et reconnu. Une stratégie ambitieuse, à condition de la concrétiser.
Un accord fondé sur la réalité du terrain
Ainsi l’apprentissage transfrontalier tel qu’il est désormais possible permet à un jeune résident en France ou en Allemagne de suivre sa formation théorique dans son pays tout en réalisant sa formation pratique (en entreprise) dans l’autre. Le tout dans un cadre sécurisé : reconnaissance des diplômes, droits sociaux préservés, accompagnement administratif par les chambres consulaires et les services publics.
« Je salue le travail remarquable mené avec l’Allemagne, pays voisin et ami, qui nous permet aujourd’hui de poser la première pierre d’un grand espace européen de l’apprentissage »
Jean-Noël Barrot, Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères
Ce dispositif s’adresse aux jeunes de la formation professionnelle initiale (souvent entre 15 et 25 ans), mais aussi aux adultes en reconversion ou en formation continue. Il prend en compte la réalité des bassins de vie transfrontaliers, où la frontière administrative ne reflète plus les échanges quotidiens réels.
Prenons un cas concret : un élève scolarisé à Strasbourg peut aujourd’hui effectuer son apprentissage en entreprise à Karlsruhe, avec une reconnaissance juridique de son parcours. Inversement, un jeune Allemand du Bade-Wurtemberg peut faire sa formation en entreprise en Alsace, tout en suivant ses cours théoriques en Allemagne. Jusqu’à mille jeunes pourraient bénéficier de ce cadre chaque année, selon les estimations du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. «Je salue le travail remarquable mené avec l’Allemagne, pays voisin et ami, qui nous permet aujourd’hui de poser la première pierre d’un grand espace européen de l’apprentissage», a ainsi salué Jean-Noël Barrot, ministre en charge de l’Europe et des Affaires étrangères.
Un outil au service des territoires et des entreprises
De plus, la force de cet accord est de valoriser les dynamiques locales. Il encourage les régions françaises et les Länder allemands à conclure des conventions spécifiques pour adapter les modalités d’application aux réalités du terrain. Il donne un cadre clair aux entreprises souhaitant recruter au-delà de la frontière, tout en sécurisant juridiquement les employeurs.

Cela s’inscrit dans un contexte où la formation professionnelle est en pleine mutation. Les entreprises européennes, notamment industrielles, peinent à recruter dans certains métiers en tension. Or, l’apprentissage est une voie d’excellence pour répondre à ces besoins, en formant les jeunes au plus près des réalités du marché du travail.
« L’apprentissage transfrontalier entre nos deux pays permettra à nos jeunes de découvrir de nouvelles opportunités professionnelles, de renforcer leurs compétences linguistiques et de s’exposer à de nouvelles cultures d’entreprise »
Astrid Panosyan-Bouvet, ministre chargée du Travail et de l’Emploi
Dans les régions frontalières, cet outil est d’autant plus précieux qu’il permet d’élargir le vivier de compétences disponibles. Il contribue également à ancrer les jeunes dans leur territoire, tout en leur offrant une perspective européenne.
Des bénéfices immédiats pour les jeunes et les familles
Pour les Français résidant en Allemagne – qu’ils soient installés à Berlin, Munich, Stuttgart ou dans des régions frontalières comme la Sarre – ce dispositif est porteur d’opportunités nouvelles. Il permet à leurs enfants de s’inscrire dans un parcours binational, enrichi par la langue et la culture de l’autre, sans renoncer à leurs racines.
Les avantages seraient multiples :
- Développement de compétences linguistiques solides, désormais indispensables dans un marché du travail globalisé ;
- Meilleure employabilité, notamment dans les régions où les frontières ne sont plus une barrière mais un atout ;
- Expérience interculturelle valorisée dans le monde professionnel ;
- Possibilité de rester proche de sa famille tout en profitant d’un éventail élargi de formations et d’entreprises d’accueil.
C’est en ce sens qu’Astrid Panosyan-Bouvet, ministre chargée du Travail et de l’Emploi souligne que « L’apprentissage transfrontalier entre nos deux pays permettra à nos jeunes de découvrir de nouvelles opportunités professionnelles, de renforcer leurs compétences linguistiques et de s’exposer à de nouvelles cultures d’entreprise, en étant chacun des ambassadeurs de leur propre pays auprès de leurs pairs. »
Vers une Europe de l’apprentissage ?
La France partage une frontière terrestre avec huit pays européens, dont six États membres de l’Union Européenne. Le potentiel d’extension de ce modèle est donc considérable. Certains pays comme le Luxembourg recrutent déjà des apprentis français, mais les dispositifs sont souvent complexes, sans cadre juridique clair. D’autres, comme la Belgique, l’Italie, l’Espagne, disposent de bassins transfrontaliers dynamiques et d’une tradition de coopération locale.

Par ailleurs, des régions comme la Suisse Romande, l’Andorre ou la Vallée d’Aoste partagent une langue avec la France, facilitant les échanges. Rien ne s’oppose à ce que des accords similaires soient conclus dans les années à venir. Le cadre juridique français le permet. Ce qu’il faut désormais, c’est une volonté politique commune, et une stratégie européenne coordonnée. À moyen terme, l’Union européenne pourrait jouer un rôle de catalyseur. Les outils existent déjà : Erasmus+, FSE+, Interreg, le Traité d’Aix-la-Chapelle, le processus de Bologne… Ce qu’il manque, c’est une reconnaissance pleine de l’apprentissage comme levier d’intégration et de cohésion.
Un enjeu politique et diplomatique
Toutefois, ce sujet touche au cœur du projet européen. Il s’agit de bâtir une Europe concrète, celle du quotidien. Pas celle des sommets, mais celle des lycées professionnels, des PME, des centres de formation, des chantiers, des ateliers,…En investissant dans l’apprentissage transfrontalier, la France et l’Allemagne rappellent qu’une Europe forte passe aussi par l’inclusion sociale, la formation, la valorisation des compétences. Elles affirment, en actes, que la jeunesse mérite une attention particulière.
Il s’agit aussi d’un enjeu de langue et de diplomatie culturelle. Pour faire vivre ces dispositifs, il faudrait renforcer l’apprentissage des langues dès l’école, notamment de l’allemand et du français dans le cadre de l’accord franco-allemand. Et porter à l’échelle de l’Union une politique active de la francophonie, dans une logique d’ouverture et de partenariat.
Construire dès aujourd’hui l’Europe des compétences
L’accord franco-allemand sur l’apprentissage transfrontalier s’apparente à une réussite politique et administrative. Mais il ne s’agit que d’un point de départ. Il appartient désormais aux collectivités, aux chambres consulaires, aux établissements de formation, aux syndicats, aux entreprises, mais aussi aux citoyens eux-mêmes – jeunes et parents – de s’en emparer. L’Europe de demain ne se construira pas seulement dans les universités ou les grandes écoles. Elle se bâtira aussi sur les bancs des centres de formation, dans les ateliers, les laboratoires, les garages, les exploitations agricoles.
Et si ce modèle fait ses preuves, alors oui, il pourra être reproduit, amplifié, et structuré à l’échelle européenne. La formation professionnelle n’est pas secondaire. Elle est centrale. Elle est européenne par nature. L’accord entre la France et l’Allemagne le prouve. Il est temps de lui donner les moyens de devenir un levier majeur pour la jeunesse, pour les territoires, et pour l’Europe.
Auteur/Autrice
-

Gilles Roux est un juriste, entrepreneur et auteur français qui vit dans la région de Mannheim en Allemagne depuis plus de 35 ans.
Voir toutes les publications