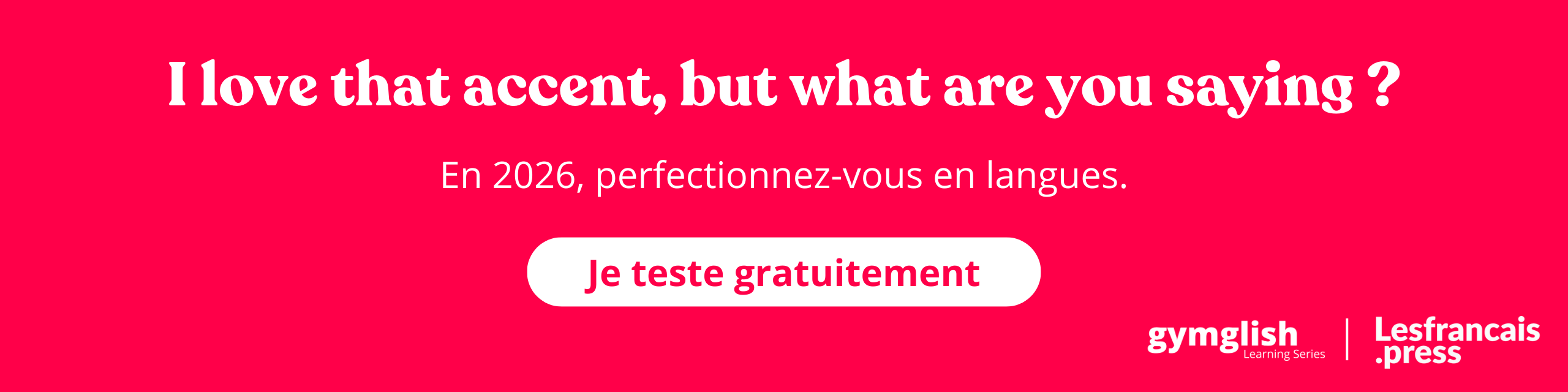Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le dollar règne en maître. Il est tout à la fois la monnaie de la première puissance économique et militaire mondiale, la première monnaie de réserve, la première monnaie pour les transactions commerciales, ainsi qu’une valeur refuge. Ce pouvoir monétaire et financier repose sur la confiance. Aujourd’hui, aucune devise n’offre les mêmes avantages que le dollar. Demain, cette confiance pourrait se lézarder.
L’hégémonie du dollar
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la domination du dollar repose sur trois piliers :
- la stabilité politique et institutionnelle des États-Unis ;
- la profondeur et la liquidité de leurs marchés financiers ;
- le statut du dollar comme monnaie de réserve mondiale.
Les États-Unis, première puissance économique financière et monétaire jouissent d’un statut de valeur refuge. La crédibilité du dollar s’appuie sur une banque centrale indépendante et un système démocratique. Le marché financier américain est de loin le premier au monde. La capitalisation des entreprises américaines représente 70 % de la capitalisation mondiale. L’importance de la dette publique américaine, près de 38 000 milliards de dollars, conforte la place financière de New-York. Les investisseurs internationaux privilégient les titres américains en raison de la garantie dont ils sont assortis et de leur rendement attractif. Les États-Unis attirent les capitaux du monde entier surtout en période de crise. Le dollar constitue la monnaie de réserve mondiale. En 2024, 59 % des réserves de change mondiales étaient, selon le FMI encore libellées en dollars, contre 19 % en euros, 6 % en yens et 3 % en yuans.
Jusqu’à présent, le dollar a résisté à de nombreuses guerres du Vietnam à l’Irak, à l’inflation des années 1970, à la crise financière de 2008, au premier mandat de Donald Trump, etc. La devise américaine peut compter sur la résilience de l’économie américaine qui représente toujours le quart du PIB mondial quand celle de l’Europe a vu son poids fondre de plus de 30 % en un quart de siècle. Le dollar est la monnaie utilisée dans plus de 50 % des transactions commerciales.
Pour autant, de nombreux dirigeants d’États rêvent de faire chuter le dollar de son trône. La dédollarisation est souvent évoquée, que ce soit de la part de la Chine ou de la Russie. Or, aujourd’hui, aucune devise n’offre les mêmes avantages que le dollar. Nul n’entend placer ses capitaux en monnaie chinoise ou russe. Même sous sanctions en lien avec la Guerre en Ukraine, de nombreux oligarques russes recourent à des sociétés écrans pour continuer à investir en dollars.
Les Chinois comptent sur leur future monnaie digitale de banque centrale pour inverser le rapport de force. Pour convaincre les États et les investisseurs à se ranger derrière leur ambitieux projets, ils peuvent compter de manière indirecte sur les foucades de Donald Trump. Les menaces répétées à l’encontre des responsables de la Réserve fédérale afin qu’ils diminuent les taux directeurs fait craindre une perte d’indépendance et donc de crédibilité de cette dernière.
La Fed a été contrainte de baisser ses taux directeurs au mois de septembre malgré une inflation sous-jacente élevée… L’ingérence du politique dans le système monétaire américain serait perçue comme un risque majeur pour les investisseurs internationaux. Ces derniers ont été déjà échaudés par la pratique de plus en plus répétée des sanctions et de l’application de la règle d’extraterritorialité permettant de poursuivre des entreprises ou des personnes étrangères qui ne respectent pas le droit américain. L’évolution des finances publiques constitue également un sujet de préoccupation. Le déficit fédéral dépasse 7 % du PIB en 2025, et la dette publique atteint 129 % du PIB (contre 98 % en 2019). Il en est de même avec l’évolution du déficit commercial américain, qui a atteint un niveau record en 2024 avec plus de 1 000 milliards de dollars. Ces déficits alimentent le monde entier en dollars et l’expose à un mouvement général de défiance. L’économie américaine vit ainsi au crédit du monde. Le dollar, en circulant partout, exporte la dette américaine comme jadis Rome le faisait avec ses sesterces. Comme pour Rome, la foi pourrait un jour s’affaiblir en raison de l’excès de dollars en circulation.
Les BRICS, la baisse du dollar et la hausse de l’euro
Depuis le début de 2024, les banques centrales émergentes — Chine, Inde, Brésil, Russie — réduisent leur exposition au dollar. La part des réserves détenues en dollars par les pays du BRICS est passée de 70 % en 2010 à 45 % en 2025, témoignage d’un changement d’état d’esprit. Ces banques centrales achètent, en contrepartie, de grande quantité d’or soutenant le cours de cette dernière. À ce titre, la banque centrale chinoise (PBoC) a augmenté ses réserves en or de 2 000 tonnes en cinq ans, tandis que les échanges intra-BRICS en yuans ont été multipliés par trois depuis 2020. La part du dollar dans les transactions internationales SWIFT est passée de 44 % à 38 % entre 2021 et 2025, tandis que celle du yuan est passé à 7 %. Le Sud entreprend de réduire son exposition au Sud.
La baisse du dollar provoque par ricochet l’appréciation de l’euro qui est la deuxième monnaie de réserve à l’échelle mondiale. Cette appréciation est logique car la zone euro dégage un excédent courant de plus de 2 % du PIB, tandis que les États-Unis affichent un déficit de 3,5 %. Ces dernières années, la faible valeur de l’euro était imputable à la guerre en Ukraine et la faible croissance de la zone euro. Avec le retour de Donald Trump au pouvoir, la parité euro/dollar, qui était tombée à 0,95 en 2022, a déjà rebondi à 1,18 à l’automne 2025. Certains analystes, comme Goldman Sachs, évoquent un retour à 1,25 en 2026.

Pour certains, l’augmentation de l’euro est une aubaine quand, pour d’autres, elle constitue un handicap sur le plan économique. L’appréciation de l’euro réduit la facture des importations, en particulier celle du pétrole. Cela avantage des pays comme la France dont la balance commerciale est fortement déficitaire ; de même pour l’Allemagne dont la compétitivité a été mise à mal par la hausse du prix du gaz et du pétrole après le déclenchement de la guerre en Ukraine. En revanche, la hausse de l’euro peut pénaliser les exportations.
Le véritable moteur du dollar reste le rendement de ses actifs. En 2025, le taux réel américain à dix ans (taux nominal moins inflation) reste positif, autour de +1,5 % et supérieur aux rendements des titres européens équivalent. Ce différentiel attire les capitaux et maintient artificiellement la valeur du dollar. En revanche, il a un coût : un service de la dette publique de plus en plus important. Les intérêts versés par le Trésor américain atteignent 1 100 milliards de dollars par an, soit plus que le budget combiné du Pentagone et de la NASA. Pour cette raison, Donald Trump entend faire baisser les taux d’intérêt en faisant pression sur la Réserve fédérale, voire en imaginant des dispositifs imposant des taux plus faibles aux non-résidents. Le risque est de remettre en cause le rôle du dollar comme valeur refuge et de réduire le flux de capitaux dont l’économie américaine a besoin.
Monnaie de réserve
L’histoire montre que les monnaies de réserve ne meurent pas de déficits, mais de ruptures politiques. La livre sterling a perdu son statut de monnaie mondiale après 1945, non à cause de sa dette, mais parce que l’Empire britannique avait perdu la maîtrise de ses flux commerciaux et énergétiques. La puissance économique et financière avait basculé du côté des États-Unis. A son tour, le dollar, dépend de la stabilité de son empire économique. Les guerres tarifaires engagées par Donald Trump, la sortie des États-Unis de plusieurs institutions multilatérales, la méfiance des alliés européens et les volte-face de Donald Trump sont autant de fissures dans la confiance mondiale dans le dollar. La grande chance de ce dernier est qu’aucune alternative crédible n’existe pour le moment. La meilleure preuve est que la « vieille relique », l’or, joue le rôle de valeur refuge, l’once ayant dépassé, au mois d’octobre 2025, les 4 000 dollars. Cependant, l’or ne peut pas servir d’unité de compte dans une économie numérique.
Désormais convertible pour les transactions commerciales dans 134 pays, le yuan souffre encore du contrôle des capitaux en Chine. Sa part dans les réserves mondiales ne dépasse pas les 5 %, ce qui est faible pour un pays devenu la première puissance commerciale du monde. L’euro demeure une monnaie régionale qui peine à franchir les frontières de l’Union européenne. L’absence d’un marché unifié des capitaux et d’émission d’obligations européennes pénalise la monnaie unique. Les cryptoactifs, comme le Bitcoin, bénéficient d’un attrait mais restent trop volatils pour servir de référence monétaire.
La mort du dollar n’est pas pour demain mais la fin de son monopole s’avance. L’économie mondiale s’oriente vers une multipolarité monétaire où plusieurs devises coexistent sans hégémonie. Selon les projections du FMI, en 2035, la part du dollar dans les réserves de change mondiales tomberait à 45 %, celle de l’euro atteindrait 25 % et celle du yuan 15 %. Les actifs numériques stables pourraient représenter 5 % des réserves. Cette transition ne signifierait pas un effondrement du dollar, mais une dilution de sa puissance — un retour au monde d’avant 1914, où la livre, le franc et le mark coexistaient avec des risques financiers accrus.

Face à cette recomposition, l’Europe a des atouts. Pour la première fois depuis vingt ans, l’euro inspire davantage de confiance que le dollar dans les marchés obligataires, la dette publique de la zone euro se négocie à un rendement moyen inférieur de 70 points de base à celui des Treasuries américains. Ce capital de confiance ne se développera que si l’Union renforce sa cohésion financière et budgétaire. Sans politique commune, l’euro ne deviendra jamais une vraie monnaie mondiale, il restera un grand marché sans souveraineté. Au moment où une réelle opportunité de reconquête d’un pouvoir financier se fait jour, les responsables européens semblent vouloir tourner le dos à la construction européenne. Près du but, ils rechignent à avancer vers un fédéralisme budgétaire.
L’histoire est libre. L’euro peut devenir la monnaie du XXIe siècle mais cela suppose que les dirigeants européens y croient. Il peut s’appuyer sur une banque centrale reconnue et indépendante, sur des États démocratiques et sur le plus puissant marché commercial du monde, l’Union européenne.
Auteur/Autrice
-

Philippe Crevel est un spécialiste des questions macroéconomiques. Fondateur de la société d’études et de stratégies économiques, Lorello Ecodata, il dirige, par ailleurs, le Cercle de l’Epargne qui est un centre d’études et d’information consacré à l’épargne et à la retraite en plus d'être notre spécialiste économie.
Voir toutes les publications