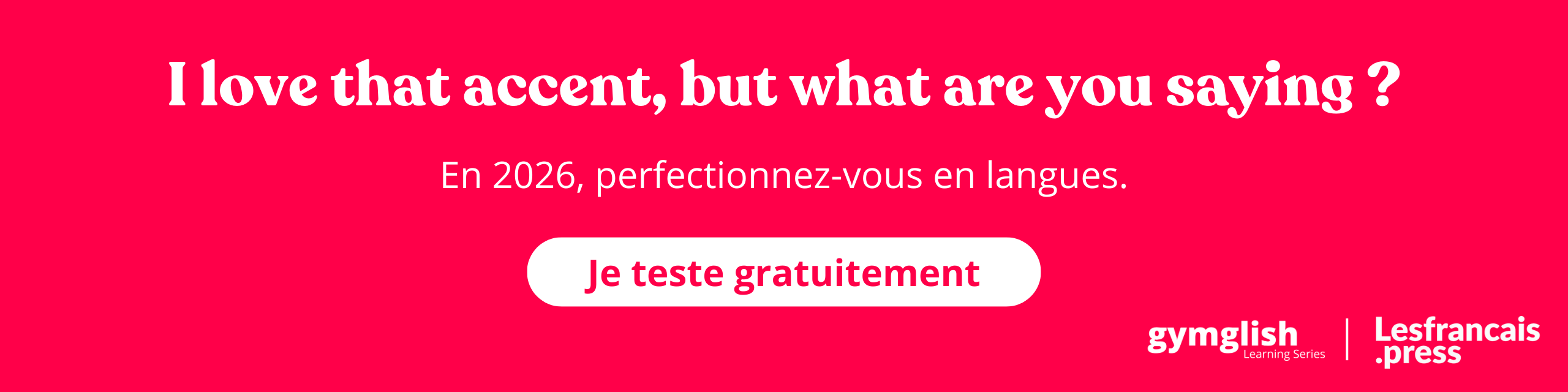Les dirigeants de l’UE ont franchi une étape importante jeudi 23 octobre pour combler les lacunes militaires de l’Europe, tout en laissant en suspens les questions de gouvernance, de financement et de mise en œuvre, qui devront être réglées dans les prochains mois.
La feuille de route de la commission
L’ampleur du défi est considérable. Les États membres s’attaqueront aux neuf lacunes en matière de capacités identifiées par la Commission, qui vont des munitions, des missiles et de la défense aérienne au cyberespace, à l’IA, aux drones et à la mobilité militaire.
Bruxelles souhaite que ces efforts débouchent sur la mise en place de plusieurs projets « phares » dans le cadre de sa feuille de route pour la préparation de la défense, notamment l’initiative européenne de défense anti-drones (EDDI), la surveillance du flanc est, le bouclier aérien européen et le bouclier spatial européen.
Mais les conclusions du sommet européen de cette semaine s’éloignent de ces objectifs ambitieux puisqu’ils ne citent aucune de ces initiatives. Les dirigeants de l’UE font uniquement référence aux « capacités anti-drones et de défense aérienne », ce qui pourrait désigner les technologies liées aux drones et anti-drones, ainsi que la défense aérienne et antimissile.
Quoi qu’il en soit, cela ne couvre que deux des neuf objectifs, dans des termes suffisamment larges pour laisser aux capitales une marge de manœuvre pour redéfinir leurs priorités.

L’ambitieuse feuille de route de la Commission en matière de préparation à la défense définit une série d’étapes et de calendriers, mais seules deux échéances ont été inscrites à l’ordre du jour des dirigeants de l’UE : finaliser les coalitions d’ici la fin de l’année et lancer des « projets concrets » au cours du premier semestre 2026.
Des projets à inventer
La nature de ces projets reste floue, et les capitales ont désormais moins de six mois pour mettre en place des groupes avec des responsables — ou des co-responsables — et décider où investir exactement.
Pour António Costa, président du Conseil européen, cela constitue déjà un progrès. « Nous avons défini nos capacités prioritaires », a-t-il déclaré, ajoutant qu’elles « commenceront » par les drones, la défense aérienne et le flanc est.
Jusqu’à présent, les Pays-Bas et la Lettonie souhaitent diriger la coalition sur les drones (EDDI).
L’Allemagne s’intéresse quant à elle à la défense aérienne et antimissile, au combat terrestre et à la défense maritime. La France vise à diriger ou à rejoindre cinq coalitions, notamment dans les domaines de la défense aérienne, de l’artillerie et de l’espace, selon les informations recueillies par Euractiv.

Pour les dirigeants de l’UE, la mise en œuvre et la supervision restent entre leurs mains. Le président français Emmanuel Macron a déclaré jeudi que c’était leur travail, conformément aux traités de l’UE.
Pour soutenir ce processus, ils ont chargé l’Agence européenne de défense, une agence intergouvernementale, d’aider à mettre en œuvre la feuille de route et de présenter un rapport annuel pour suivre les progrès réalisés, selon les conclusions du sommet.
La Commission, quant à elle, s’est posée en « facilitatrice », offrant une assistance technique et des conseils pour aligner les initiatives des capitales sur les financements existants de l’UE, notamment les 150 milliards d’euros de prêts Security Action For Europe (SAFE) et le programme européen pour l’industrie de la défense (EDIP) de 1,5 milliard d’euros.
Le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré que l’UE pouvait renforcer les défenses de l’Europe « dans les domaines où elle dispose de ses propres compétences », citant la nécessité d’accélérer la planification de la production et les procédures d’approbation.
António Costa a salué les discussions sur la défense lors du sommet comme un « élément déterminant » pour la souveraineté de l’Europe, même si, pour l’instant, la structure reste largement à l’état de projet.