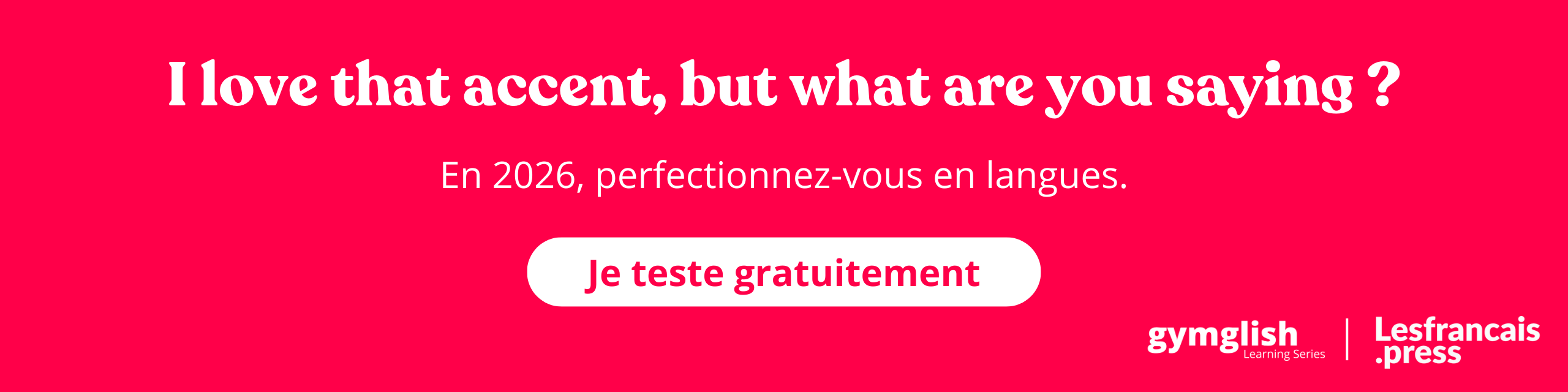De manière surprenante, au sein des équipes de Donald Trump, la thèse du caractère négatif du rôle dominant du dollar est amplement partagée. Stephen Miran, le nouveau président du Council of Economic Advisors, est l’un des partisans les plus zélés de la remise en cause du dollar comme monnaie mondiale. Il estime que le dollar, en tant qu’actif de réserve international, conduit à son appréciation, ce qui pénalise l’économie américaine en favorisant la désindustrialisation. De 2005 à 2024, le poids de l’industrie dans le PIB est, en effet, passé de 12 % à 10 %.
L’argument n’est pas nouveau. Dès les années 1960, l’économiste belge Robert Triffin soulignait que pour fournir au monde les liquidités nécessaires au commerce international, les États-Unis devaient inévitablement enregistrer des déficits extérieurs croissants, au risque de saper la confiance dans leur propre monnaie. Valéry Giscard d’Estaing parlera plus tard du « privilège exorbitant » du dollar. Ce privilège est désormais ouvertement contesté… depuis Washington.
Le dollar s’est globalement renforcé depuis 2008
En observant le taux de change du dollar depuis 1995, on constate que le billet vert s’est apprécié par rapport à l’euro depuis 2008, au yen depuis 2012, et au renminbi chinois depuis 2014. Par rapport à l’ensemble des principales devises, le dollar s’est globalement renforcé depuis 2008.
Pour endiguer ce processus, le conseiller économique de Donald Trump propose de contraindre les partenaires économiques des États-Unis à vendre une partie de leurs réserves en dollars dans le but de provoquer une dépréciation de la monnaie américaine, sous la menace d’une hausse des droits de douane.

La corrélation entre l’évolution du taux de change du dollar et le poids de l’industrie n’est cependant pas évidente. La faiblesse du billet vert entre 2004 et 2014 n’a pas enrayé la désindustrialisation. Par ailleurs, le poids du dollar dans les réserves de change mondiales décline : il est passé de 70 % en 1999 à 58 % en 2024.
Des flux massifs de capitaux internationaux, qui financent à la fois les administrations publiques et les entreprises.
Le dollar demeure un formidable atout pour l’économie américaine. Il permet aux États-Unis d’afficher en permanence un déficit de leur balance courante et d’accumuler une dette extérieure nette très importante. Le déficit courant américain s’est ainsi élevé à 4 % du PIB en 2024. La dette extérieure nette du pays est passée de 10 % à 80 % du PIB entre 2006 et 2024. Le rôle de valeur refuge du dollar attire des flux massifs de capitaux internationaux, qui financent à la fois les administrations publiques et les entreprises.
Une large part des investissements dans le secteur des technologies de l’information et de la communication est d’ailleurs financée par des capitaux étrangers. Ces investissements sont passés de 3 % à 4 % du PIB entre 1995 et 2025, un niveau nettement supérieur à celui observé dans l’Union européenne.
La montée en gamme de l’économie américaine a été rendue possible grâce au « privilège exorbitant » du dollar. Si celui-ci venait à être remis en cause en tant qu’actif de réserve mondial, les États-Unis seraient contraints d’équilibrer leur balance courante. Un tel rééquilibrage s’accompagnerait vraisemblablement d’une récession, avec à la clé une baisse des investissements.
La montée en gamme de l’économie américaine a été rendue possible grâce au « privilège exorbitant » du dollar.
La critique du dollar, jadis apanage de puissances émergentes comme la Chine ou la Russie, rejoint aujourd’hui les rangs d’un nationalisme économique américain qui confond dépendance et puissance. Dans ce domaine, toute initiative unilatérale comporte un risque de retour de flamme.
La Chine, les BRICS, voire certains pays du Golfe, travaillent déjà à contourner le dollar dans leurs échanges. Si les États-Unis eux-mêmes s’engagent dans cette direction, ils pourraient perdre plus qu’ils ne pensent gagner. En jouant avec la monnaie, les apprentis sorciers finissent souvent par se brûler les doigts.
Laisser un commentaire